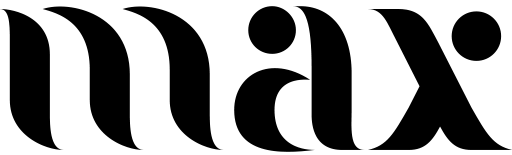«Un bon livre est un livre que l’on regrette d’avoir terminé». Cette phrase, on ne l’a pas entendue de la bouche de Joël Dicker, mais de celle d’un de ses héros, Harry Québert. Un bon livre de Joël Dicker, c’est comme son dernier «L’affaire Alaska Sanders», une «brique» addictive qu’on a du mal à refermer.
Rencontre avec l’écrivain suisse, désormais aussi patron de sa maison d’édition, qui, ces 10 dernières années, a rendu la bonne lecture sexy.
Joël, «L’affaire Alaska Sanders», est le premier roman que vous publiez dans votre propre maison d’édition. Quand vous évoquez votre ancien éditeur, votre mentor, Bernard de Fallois, vous êtes très ému…
Je suis quelqu’un de fidèle. Et ce que raconte aussi un peu ce livre, c’est aussi l’amitié entre Marcus et Perry, une amitié fidèle dans ce que la fidélité peut avoir de très fort, qui résiste au peu de nouvelles, au temps. Il y a des amis que tu vois très souvent mais est-ce que ce sont ceux que tu peux appeler à deux heures du mat’ si tu as un problème? Et il y a des gens qui ne sont pas forcément ceux qui sont dans ton entourage direct qui, eux, seraient là. Je ne suis pas quelqu’un de très doué pour donner des nouvelles, surtout dans ce monde de la connexion. Je trouve que la connexion nous a un peu tués. Avant, le téléphone —sans parler comme un vieux loup (sourire)— était une activité. On pouvait passer des soirées au téléphone, en bloquant la ligne. C’était une vraie soirée d’échange, il s’était passé quelque chose. Tandis qu’avec le portable, on a perdu ça, ces rendez-vous avec l’autre. Je ne suis pas bon dans les rendez-vous courts.

Vous évoquez la relation de votre héros Marcus Goldman avec le sergent Perry Gahalawood, qui reviennent tous deux dans ce roman. Il y a aussi la relation plus compliquée de Marcus avec Harry Québert…
Je crois que Perry est un vrai ami pour Marcus. C’est sa famille, et c’est aussi l’idée que la vraie famille ce sont les amis. Ta famille, tu ne la choisis pas… et ça ne la rend pas moins importante. Mais c’est une relation qui s’est construite sur une évidence un peu inquestionnable, en général. C’est un lien socialement acquis. À côté, au rang de l’intimité de ceux qui nous connaissent vraiment, les amis sont mieux placés. Parce que les amis nous connaissent plus directement, ils n’ont pas forcément ces rapports conflictuels, biaisés, ces projections. Un ami, c’est quelqu’un qui nous connaît bien et qui nous aime quand même. Perry, il est vraiment ça pour Marcus. À l’inverse, avec Harry, c’est une relation plus compliquée, je le vois comme une dualité, comme deux versants de la personnalité de Marcus qui, lui, est en quête d’identité.
Vous-même avez un questionnement sur votre identité. Aurez-vous un jour la réponse?
Je pense que ce questionnement prendra fin parce que d’autres questions m’appelleront. Mais ça a été un peu le bouleversement dans ma vie parce que j’ai toujours écrit et, du jour au lendemain, on a dit: «c’est l’écrivain Joël Dicker». Je me suis demandé ce que j’avais fait. Je peux comprendre, rationnellement, l’idée que tout à coup un livre a du succès et que je l’ai écrit. Mais ça devient vraiment une forme d’identité. Une identité même dans le regard de gens proches qui savaient pourtant que j’écrivais depuis longtemps. Moi-même je me sens plus écrivain aujourd’hui qu’avant parce que j’ai une légitimité dans le regard des autres. Ça a appelé beaucoup de questions en moi. Pourquoi le thème de l’écriture revient dans «La vérité...», «L’énigme de la chambre 622» et dans «L’affaire Alaska Sanders»? Eh bien, parce qu’au fond ça raconte une période de ma vie. Et ces questionnements, on pourra les expliquer dans 30 ans, en reprenant ces livres. On y verra un jeune homme qui n’est plus un jeune adulte mais pas encore un vieux non plus; qui entre dans la quarantaine et qui rejoint une équipe «d’anciens» car il n’a plus 20 ans. C’est une étape importante dans la bascule de l’identité. J’ai des enfants qui sont petits et quand on leur demandera plus tard ce que leur papa fait dans la vie et qu’ils répondront «écrivain», c’est quelque chose que j’assumerai pleinement. Et ça n’aurait pas été le cas il y a même cinq ans.

Dans le livre, un personnage lance qu’un écrivain est narcissique. Avez-vous craint que le narcissisme s’installe dans votre vie?
Non, parce qu’après cette période-ci de promotion, je ferme ma porte et je redeviens un artiste pas sûr de lui, de ce qu’il veut faire, plein de doutes. Bernard disait d’ailleurs: «Il y a deux Joël. Celui qu’on connaît, là devant nous et qui parle aux journalistes, qui est de bonne humeur, poli,… Et celui qu’on ne connaît pas, qu’on ne connaîtra jamais, qui est le Joël enfermé dans son bureau pour écrire».
Votre maman tenait une librairie, votre père était professeur de français. Les lettres, c’était votre destin… Vous avez quand même hésité?
Il y avait une attirance, quelque chose de très lié à l’écriture et à la lecture. Après, que je devienne écrivain comme ça, c’était moins évident, ne seraitce que parce que j’ai eu cinq romans refusés partout et le premier qui a été publié («Les derniers jours de nos pères») n’a pas marché du tout. Je n’avais donc pas la conviction que j’allais en faire mon métier. Mais j’avais cette envie que ce soit un exercice qui m’accompagne.