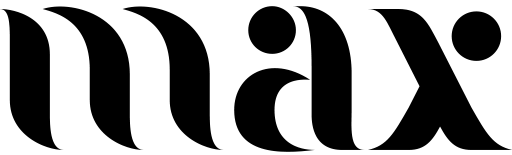Le malheur. Des petits et des grands malheurs. Le malheur de notre vie. Le malheur menace, telle un épée de Damoclès, la quiétude de nos journées dont il peut entraver le cours.
Le malheur peut détruire des parcelles de nos existences ou nos existences entières. Mais qu’est-ce qu’un malheur? Un malheur, c’est un événement dramatique qui bouleversera à jamais nos cheminements de vies: il y aura un avant et un après. Le malheur nous crible le coeur et l’âme de petites balles invisibles. Le malheur reste souvent imprévisible. Et la notion de malheur reste aussi subjective.
C’est-à-dire que l’impact que les événements peuvent avoir sur nous ainsi que leur pouvoir de destructivité sont complètement variables d’un individu à l’autre. En fonction de notre culture, de notre sensibilité, de notre représentation du monde et de notre vécu, ce qui causera du malheur à l’un n’en causera pas à l’autre. En psychothérapie des traumatismes, on sait que l’impact d’un événement sur nous et sa capacité à produire des traumatismes tient toujours de la représentation que nous nous en faisons plus que de sa gravité intrinsèque.
L’écueil auquel je suis souvent confrontée tant dans ma profession de thérapeute que dans mes observations quotidiennes, c’est cette forme de hiérarchisation des malheurs que nous opérons les uns vis-à-vis des autres pour tolérer, autoriser et légitimer l’expression de la peine ou du chagrin. Nous jugeons et nous évaluons constamment le rapport entre le type de drame qui nous touche et la peine que nous éprouvons. Nous autorisons ou n’autorisons pas les autres à ressentir du chagrin en fonction de la «gravité» du drame qui les touche.
Ce mécanisme délétère que nous mobilisons souvent inconsciemment peut entraîner de lourdes conséquences sur la santé mentale de nos proches. Nous devenons des terroristes émotionnels en jugeant ceux et celles pour lesquels nous estimons que le chagrin n’est pas justifié, en les taxant d’un excès de sensiblerie, de «drama queen» attitude, ou de fragilité excessive.
Marie a 38 ans. Célibataire et sans enfant, elle avait pour unique compagnon son golden retriever, Scott. Scott vient de mourir. Il a 10 ans. Marie est isolée socialement, elle a peu d’amis et une famille avec laquelle elle a coupé les ponts depuis plus de 15 ans. Scott représente plus qu’un chien pour Marie, vous l’aurez compris. Esseulée et déçue par la nature humaine qu’elle a davantage appris à éviter plutôt qu’à idéaliser, tout son amour s’est concentré sur un seul être: Scott. Suite à son décès, Marie tombe dans une profonde dépression. La double peine vécue par Marie, c’est d’une part la souffrance de la perte, et d’autre part, d’éprouver de la honte à l’idée d’avouer que son effondrement émotionnel est lié à la mort de son animal domestique.
Lucie a 30 ans, elle vient de perdre sa maman des suites d’un AVC de manière inopinée. Lucie n’est pas fort impactée par ce drame: elle entretenait avec sa maman une relation distante dénuée d’affection.
Deux femmes. Deux vécus. Deux singularités. Deux types de deuils. Deux manières légitimes de les vivre. Deux nécessité de ne pas être jugées. Un ressenti se dit et ne se contredit pas. Toute souffrance, et quelle qu’en soit l’origine, mérite d’être accueillie et entendue. Si le chagrin de Marie est plus intense que celui de Lucie, nous n’avons pas à les juger. Nous avons tous une histoire, un vécu, des vulnérabilités, des forces et des combats à mener. Il en va de notre liberté fondamentale d’exister en tant qu’être humain et de nous sentir autorisés à éprouver sans avoir à prouver!