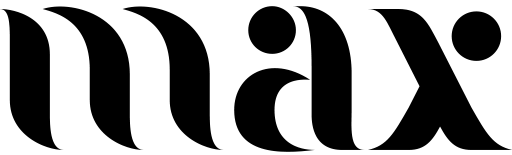Elle demeure l’icône de l’info, sept ans après la fin de «son» 20 heures. Arrêter la télé, elle y a songé réellement. Car le petit écran, ce n’est pas une drogue pour elle… La culture, un peu plus. Cet été, au festival de Lacoste, en Provence, entre deux lectures de rentrée, Claire Chazal a discuté art, info et féminisme avec nous. Rencontre avec une icône… tout court.
Claire, on vous sait –et vos émissions («Passage des arts», «Le gand échiquier» ) en témoignent– grande passionnée d’art, sous toutes ses formes. D’où vous vient cette passion pour la culture?
C’est venu très tôt, dans l’enfance en fait, avec d’abord la lecture, parce que j’aimais ça naturellement. Alors, bien sûr, ma mère était professeur de français. J’étais sans doute influencée. J’étais une enfant plutôt contemplative. J’ai commencé bien sûr par les lectures d’enfant, à l’école, avec la comtesse de Ségur, etc... Et j’ai gardé ce goût pour la littérature tout le temps. Après, est venue aussi assez rapidement la danse, que je pratiquais. Et dès que j’ai pu aller voir des ballets, comme la compagnie Maurice Béjart, j’y suis allée avec des amis, assez tôt d’ailleurs. C’est ce qui me plaisait le plus. Et puis, très vite aussi, le théâtre est venu, vers mes quinze-seize ans. Je me souviens vraiment qu’une de mes premières émotions, c’était une pièce de Shakespeare que Peter Brook avait mise en scène. J’ai eu la chance après d’aller à l’opéra. Mais j’y suis plus allée avec des amis qu’avec mes parents qui étaient des gens qui avaient une culture classique, très livresque.
On a l’habitude de vous regarder le dimanche soir sur France 2 dans «Passage des arts» mais il y a aussi l’émission mythique, «Le grand échiquier» que vous présentez depuis quelques mois. C’est le Graal quand on est une passionnée d’art?
Oui, je regardais cette émission à l’époque. Ça a été un très beau cadeau parce que vraiment j’aimais cette émission présentée par Jacques Chancel. Je trouve que c’est une des plus belles émissions du service public. On ne peut pas l’imaginer sur une chaîne privée, c’est trop compliqué. C’est malheureusement la réalité. Moi, je faisais des journaux dans lesquels j’essayais de mettre de la culture, mais on était peut-être pas prêts. Je n’aurais jamais pu faire toute une émission culturelle en tout cas. Ce que Patrick (Poivre d’Arvor) a fait, lui, avec son émission littéraire, qu’il a imposée même si c’était assez tard dans la soirée. Mais au moins ça existait! Le service public peut encore offrir ça. J’ai quand même réussi à faire imposer une émission sur Molière. Si nous ne faisons pas une émission sur Molière, qui va la faire?
Ce féminisme victimaire d’aujourd’hui me paraît être une façon de rabaisser un peu la personnalité féminine
On a l’impression que ces émissions culturelles vous rendent plus fière que vos 24 années de «reine de l’info»…
Non, c’est autre chose. C’est une reconversion qui m’a beaucoup plu. Je sais que j’ai eu beaucoup de chance après TF1, de trouver cette façon de m’exprimer sur la culture, sur France Télévisions.
Si Michel Field (France 5) ne vous avait pas proposé une émission culturelle rapidement après l’arrêt de «votre» JT, vous auriez arrêté la télé?
Oui, j’aurais arrêté la télévision. Et cela n’aurait pas été grave.
(...)
Est-ce que la télé peut être une drogue quand on est dedans et quand on est porté aux nues?
Je ne dirais pas que la télévision est une drogue, mais le journalisme en est une, qu’il soit de presse écrite, de radio. La télévision j’ai eu de la chance d’en faire mais je n’ai jamais considéré ça comme une drogue.
Vous semblez très détachée…
Disons que j’ai autant de plaisir à faire un papier de presse écrite ou une interview en radio. Je faisais ce que vous faites vous, et ça m’a beaucoup intéressée.

Si c’était à refaire, vous referiez de la télé? Parce qu’il y a quand même un revers à la médaille, qui est la surmédiatisation…
Oui, mais c’est quand même agréable. Ce n’est pas une souffrance.
Jamais vous n’avez souffert de cette surmédiatisation? Quand vous faisiez régulièrement la Une des magazines people, etc?
Non, je ne dirais pas ça. Je n’en ai pas souffert, du tout. Bien sûr, il y a des journaux un peu intrusifs dans la vie privée mais ça a toujours existé. Par rapport au plaisir qu’on a, je ne suis pas d’accord. S’il fallait refaire, je referais. Mais j’aurais très bien pu aussi faire ma vie de journaliste dans la presse écrite. La télévision est venue par hasard.
(...)
«Je suis libre de faire ma vie: c’est ça mon féminisme!»
Vous dites que votre carrière, ça a été beaucoup de combats, mais pas forcément un combat féministe pour vous, de réussir à votre poste?
Non, je crois que c’est très générationnel. J’appartiens à une génération qui a été nourrie au lait féministe, suite à cette émancipation extraordinaire qui est arrivée après la guerre. J’en ai bénéficié et j’ai été intéressée par tout ce qu’écrivaient ces femmes, comme Simone de Beauvoir ou Gisèle Halimi. Donc, nous, on avait déjà une voie tracée et on n’aurait jamais pensé que nous n’occuperions pas une place dans la société qui soit l’égale de celle des hommes. Moi, j’ai toujours vécu en me disant que j’ai les mêmes diplômes que les garçons –et même souvent plus!– j’ai la même place, je suis aussi intelligente qu’eux et je suis libre de faire ma vie. C’est ça mon féminisme.
Et le féminisme d’aujourd’hui, vous le comprenez?
Je le comprends moins parce que j’ai plus eu comme exemples des féministes de combat, des héroïnes, des femmes qui s’étaient battues et qui n’avaient pas de doute sur leur place. Et ce féminisme victimaire d’aujourd’hui me paraît être une façon de rabaisser un peu la personnalité féminine. Je ne me reconnais pas dans ce féminisme, je viens d’un milieu où on fait des études, où on sait se défendre. Bien sûr, il faut mettre un bémol, je suis tout à fait d’accord pour dire qu’il y a évidemment le drame des violences faites aux femmes, le drame des violences conjugales, que c’est un fait qu’il faut prendre à bras le corps pour que les voix de ces femmes soient entendues. Je ne sais pas si les féministes d’aujourd’hui ont envisagé les féministes comme des héroïnes. Elles ont peut-être plus envisagé les féministes comme des victimes. Je conçois qu’elles aient pu souffrir de certaines choses. Mais je pense qu’il y a des écueils dans leur féminisme: il y a le risque de banaliser le viol. Parce que le viol est un vrai drame, j’entends le viol qui menace la vie d’une femme et qui malheureusement, parfois, la lui ôte. Je me sens une femme qui peut se défendre, qui peut exister. Je n’ai pas envie qu’on me plaigne, moi. Je n’ai d’abord jamais souffert de ma condition de femme. J’ai vécu ma vie librement. Et si on me dit qu’on exclut les hommes ou qu’on les considère comme des ennemis, voire des agresseurs systématiques, moi, ça, je ne le dis pas. Je ne l’ai jamais vécu comme ça.