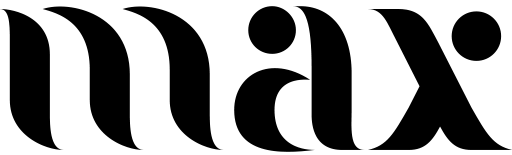Il y a quelques jours, le documentaire réalisé par Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova faisait grand bruit. «Un silence si bruyant» n’aurait pu mieux porter son titre, lui qui a vocation à faire, enfin, bouger les choses sur la question, trop longtemps laissée en suspens, de l’inceste.
«Il y a beaucoup de choses à faire dans notre société, mais il y a une chose qui avance, c’est une prise de conscience et une chaîne de solidarité –et de colère aussi, en se demandant ce que font les institutions– qui commence à se dessiner…», nous disent en cœur les deux réalisatrices, déterminées à lutter pour que les choses changent.
Ce documentaire, c’est aussi le recueil d’une confession lourde pour l’actrice, victime d'inceste entre ses 11 et ses 15 ans. «Depuis toujours, je me demandais quel était le moyen que je pourrais trouver pour aborder ce sujet. J’ai tenté des adaptations qui n’ont pas abouti. Et, un jour, j’ai rencontré Anastasia dont j’avais vu les films documentaires. Je me suis dit immédiatement que c’était la bonne personne. Très vite, je lui ai dit ce que je voulais faire, ce qui m’était arrivé. Je sais qu’inconsciemment, moi, ça faisait des années que je cherchais quelqu’un avec qui faire ce projet. Je savais que je n’étais pas capable de le faire toute seule, que j’avais besoin d’un regard plus distant du mien. C’était très important pour moi de trouver quelqu’un qui ne l’avait pas vécu et puisse se poser d’autres questions». Emmanuelle Béart ne prononce pas le mot «inceste». En introduction du documentaire, qui réunit quatre autres témoignages bouleversants, l’actrice exprime sa douleur d’enfant ainsi: «Si ma grand-mère n’était pas intervenue, si on ne m’avait pas mise dans ce train à l’âge de 15 ans pour rejoindre mon père, je ne suis pas certaine que j’aurais réussi à vivre: c’est aussi violent que ça, c’est aussi réel que ça».

Au fil des témoignages, quels mots sont le plus souvent revenus chez les victimes?
Anastasia: Le silence revenait dans quasiment tous les témoignages.
Emmanuelle: Dissociation. Honte. Culpabilité. Anesthésie émotionnelle. Mort aussi. Quelqu’un qui a vécu ça, c’est une forme d’assassinat. Il y a une partie de soi qui meurt. Une partie d’innocence qui meurt chez l’enfant. Une partie d’illusions, de rêves. Tout ça est englouti. Après, on a entendu le mot survivre aussi.
Anastasia: Et l’injustice... et la justice.
Vous dites dans le documentaire vouloir peut-être «apaiser (votre) propre détresse en écoutant les mots des autres». Est-ce que cela apaise réellement?
Emmanuelle: En tout cas, ce que provoque l’inceste, c’est un sentiment d’immense solitude. Tout est fait pour isoler la victime, ça fait partie de la stratégie de l’agresseur. Effectivement, quand, tout à coup, on sent qu’on est entouré de gens qui ont des séquelles qui font écho à ce que vous avez en vous, il y a cette sensation de ne pas être complètement dingue, de ne pas être folle, de ne pas être seule.
Anastasia: On a fait l’avant-première du documentaire au ministère de la Protection de l’enfance, en présence d’Eva Thomas, première femme à avoir témoigné de l’inceste à la télévision, à visage découvert. C’était hallucinant alors les réactions qu’il y a eues sur le plateau, on la dénigrait, on lui riait au nez, certains disaient «l’inceste heureux, vous connaissez?». C’était en 1986. Aujourd’hui, on se dit qu’on n’est plus à cette époque-là, que quelque chose, fondamentalement, a changé. On ne se permettrait plus ça. Par contre, est-ce que la réponse sociétale et politique est à la hauteur de la prise de parole collective de la société civile? Non!
Emmanuelle: ll faut que le système judiciaire change, que les lois changent. Il y a des injonctions contradictoires : on dit à l’enfant «parle», mais on l’accuse de mentir. On dit à la mère ou au père de protéger son enfant, de porter cette parole, et la mère –car c'est généralement elle qui parle– se trouve sur le banc des accusés, accusée de mentir, risquant de perdre l’enfant et obligée de remettre l’enfant à l’agresseur,… Voilà l’état dans lequel notre société est aujourd’hui. Et c’est d’autant plus dangereux que si un enfant parle et qu’il n’est pas entendu, pas cru, il peut se retrancher dans un silence. C’est dangereux. Il n’y a pas de protection de l’enfant.

Une question est souvent posée aux victimes qui ont le courage de parler des années plus tard: «pourquoi parlez-vous seulement maintenant?»
Emmanuelle: Et ça, on me l’a beaucoup demandé. On m’a demandé pourquoi je ne l’ai pas dit avant, pourquoi maintenant. Pourquoi je ne dis pas qui c’est…
Le documentaire n’élude aucun sujet, comme le rapport au corps. Vous êtes émue quand vous comprenez, face à un spécialiste, pourquoi vous avez mis votre corps en avant dans votre métier. Est-ce que cela vous fait reconsidérer toute votre carrière?
Emmanuelle: Non. Mais tout d’un coup, effectivement, j’ai une clé et je comprends qu’il y a eu chez moi, certainement inconsciemment, la volonté de créer une féminité, voire une sexualité qui ne lui (à l’agresseur, NdlR) appartient pas. J’ai voulu me la réapproprier. C’est bien ça qu’on demande alors à un enfant: on le déplace, il n’est plus à sa place d’enfant, dans son état d’innocence. Il est confronté à ce que vivent les adultes. J’ai été amenée à être femme avant l’heure. Ce spécialiste explique aussi qu’on croit (quand on est victime d’inceste, NdlR) qu’on ne peut être aimé que par son corps. Serait-ce la raison pour laquelle j’ai sexualisé cette image, même inconsciemment?