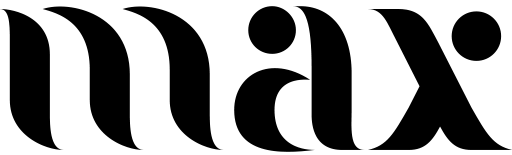Il y a chez Laetitia Casta un naturel désarmant et, toujours, une fougue rafraîchissante. «Je ne cherche pas à me mettre dans le conventionnel, ni dans un camp. Je cherche juste à être honnête», nous dit-elle après la sortie du film coup de poing «Le consentement», récit d’années d’emprise de l’écrivain pédophile Gabriel Matzneff sur la très jeune Vanessa Springora. Notre discussion est l’occasion aussi pour la magnifique actrice –qui n’a jamais vraiment prêté attention aux compliments sur son physique– de mettre certaines choses au clair.
Début 2020, Vanessa Springora publiait «Le consentement», récit choc d’une adolescence passée sous l’emprise de l’écrivain Gabriel Matzneff. Elle avait 14 ans, lui presque 50. La prédation est alors «psychologique, sexuelle et intellectuelle», rappelle aujourd’hui Laetitia Casta qui, dans l’adaptation cinématographique de l’ouvrage, incarne la mère de la jeune victime. À l’époque, dans les années 80, la pédophilie de Matzneff, son attirance pour les jeunes filles et les jeunes garçons, est connue des milieux intellectuels –et décrite même, avec force détails, dans ses romans– mais tue et acceptée. Ce n’est qu’une trentaine d’années plus tard, à l’heure de #Metoo, que le vent du scandale soufflera enfin, après la sortie du livre de Vanessa Springora. Même si, aujourd’hui encore, déplore l’actrice, Matzneff n’a pas été jugé.
Mais comment incarner la mère de Vanessa, que beaucoup ont accusée de complicité, sans la juger, sans l’accabler? «J’ai eu l’impression de marcher sur des œufs», nous confie Laetitia Casta. «À la lecture du scénario, même si tout était bien décrit, j’ai eu l’impression qu’il fallait que je mène une enquête sur ce personnage. Je suis comme entrée en empathie avec elle. C’est la seule manière de pouvoir aborder ce rôle. Je ne pouvais pas être dans une forme de jugement – comme ce qui s’est produit au moment de la sortie du livre, où les médias ont été extrêmement durs avec la mère. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire, mais que ce serait délicat. J’allais marcher sur le fil pour ne pas tomber…»

Comment décririez-vous la maman de Vanessa Springora?
Il y a d’abord une chose qui m’a sauté aux yeux: c’est l’absence du père. Ce manque d’autorité paternelle. Et qu’est-ce que cela raconte? Que le père de Vanessa, dans la relation avec la mère, est extrêmement dur, c’est un homme qui juge, qui est insultant. Elle va divorcer à une époque où ce n’est pas si fréquent et se retrouver sous les toits d’un petit appartement avec sa fille, avec rien du tout, pas de pension alimentaire. Elle va galérer pour s’en sortir dans un milieu très mondain alors que chez elle, il y a un besoin d’exister à ce moment-là, de se reconstruire en tant que femme. Elle est fragile psychiquement à la base. Elle est aussi dans un rapport fusionnel avec sa fille. Et ce qui est important de savoir, c’est que Matzneff s’intéresse toujours à des mères célibataires. Il rentre en séduisant la mère puis la fille. Et il prend cette place du père. C’est toujours la même façon d’opérer, c’est un prédateur qui fonctionne comme ça. À cette mère, l’entourage a dit: «oh tu sais bien comment ça se passe, ne fais pas genre!». Alors, on dit que c’est la faute de cette mère… Mais non, c’est celle de ce milieu, de tout ce que ça comporte! Matzneff a enrôlé sa fille… Il y a plein de nuances! J’ai trouvé ce personnage intéressant dans le reflet de nous-même qu’il renvoie. Ce questionnement: «Qu’est-ce que j’aurais fait moi à sa place? Comment j’aurais fait?».
Ce film est bouleversant et dur. Et, à la fois, il a une portée éducative presque…
Oui, complètement. Pour moi, c’est une prophétie. Je ne dirais pas que le film est dur, je dirais qu’il est vrai. On ne va plus, aujourd’hui, à la guerre avec un fusil et une fleur dedans. On sait de quoi il s’agit, on en parle et on l’explique. Surtout pour la jeune génération. C’est la réalité et c’est tellement bien que ce film existe.
Vous êtes maman de quatre enfants. Vous n’avez pas l’impression que la jeune génération est plus alertée sur le sujet qu’on ne l’était ados?
Hum… Je pense que, très souvent, on peut parler intellectuellement de sujets. Mais, dans la chair, c’est différent. On n’est pas au courant. C’est-à-dire qu’un ressenti émotionnel comme ça, quand c’est écrit sur le papier, qu’on le voit à la télévision, il y a une forme de distance malgré tout. Le fait de pouvoir mettre en images ce qui est imperceptible, l’invisible du mode d’emploi du prédateur, ça n’existe pas. Parce que dans des films comme «Lolita», on est dans quelque chose de très ambigu. On y célèbre le désir.

Récemment, vous avez donné une interview dans l’émission «Sept à huit» où vous avez expliqué comment vous avez envoyé sur les roses un Harvey Weinstein un peu pressant. Vous dites aussi que vous aviez le caractère et l’éducation pour le faire…
Certaines personnes ont pensé que je faisais la morale, parce qu’il y a des femmes qui n’ont pas la chance d’être aussi fortes que moi! Mais justement, je disais clairement que tout le monde n’a pas cette chance… Parce qu’à l’époque, j’ai rencontré des jeunes femmes qui n’avaient pas leurs parents présents, elles ne rentraient pas dans leur famille le soir, parce qu’elles étaient à l’étranger. Les seuls liens qu’elles pouvaient avoir, c’étaient les agents, le business. Moi, c’était très différent. Mais c’est dingue quand même: dès qu’on montre un peu de force, ça vient troubler.
Vous dites que les prédateurs, on les rencontre très tôt dans sa vie…
Oui, je ne les ai pas rencontrés en entrant dans le milieu du mannequinat. Je les ai découverts bien avant! Il y a des clichés qui sont encore véhiculés. On mélange tout: la culture du viol, la pédophilie, l’inceste,… Ça manque un peu, par moments, de subtilité mais je crois qu’il faut passer par là pour que, petit à petit, les choses s’équilibrent. Je me souviens qu’à un moment, on a voulu m’enfermer dans un truc féministe. On voulait choisir pour moi. Mais j’ai répondu non, que je suis surtout femme. Après, on a été dire que j’étais anti-féministe! J’ai dû m’expliquer dans un article là-dessus, alors que je ne me serais pas forcément exprimée. Mais, au final, c’était bien, ça m’a permis de mettre une voix sur des choses très importantes pour moi. Ce que je veux dire, c’est que je ne cherche pas à me mettre dans le conventionnel, ni dans un camp. Je cherche juste à être honnête. Tout ce que j’espère, c’est que les portes ne se referment pas, que ça ne crée pas des sortes de communautés qui se divisent.