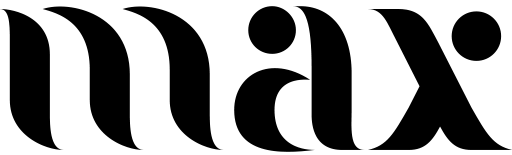On le connaît comme le romancier français le plus lu au monde. Mais quel homme se cache derrière ses personnages? Quels sont les sujets qui l’animent, lui, Marc Levy? À l’heure où il publie l’un de ses livres les plus romantiques («Éteignez tout et la vie s’allume»), l’auteur, dont la pudeur a fait la force d’écriture, parle avec nous d’amour, de déracinement et d’existence trop courte…
Marc, ce roman raconte ce que le regard de l’autre, de l’être aimé, peut provoquer chez vous, à quel point il peut vous illuminer. Pourquoi ce thème si romantique?
Parce que je crois qu’il y a des moments dans la vie où on écrit un livre pour qu’il vous prenne dans ses bras. C’est aussi simple que ça. On écrit, on peint, on sculpte parce qu’il y a des choses qu’on a terriblement envie d’exprimer et qu’on n’arrive pas exprimer tout court. Qu’est-ce qu’il se passe dans la tête de Hopper quand il peint la jeune femme à la fenêtre et la solitude dans ce bar? Il ne le peint pas juste parce qu’il en est témoin, mais parce qu’au travers de cette peinture il peint des choses qui le touchent profondément et correspondent à son état de vie à ce moment-là. Donc, j’ai peut-être écrit ce roman parce que j’avais terriblement besoin du regard d’Adèle (l’héroïne). Ou parce qu’il fallait que je dise au revoir au Jeremy qui est en moi. Mais c’est très difficile de donner une raison à ce pourquoi, il y en a plusieurs. Et puis, ce serait peut-être impudique...
Justement, vous avez toujours dit être très pudique au quotidien. Est-ce que le fait d’exprimer des émotions au travers de l’écriture vous a permis de vous libérer un peu de cette pudeur dans la vie?
Non, ça ne m’a permis d’être moins pudique mais ça m’a certainement permis de ne pas être étouffé par cette pudeur. Le problème de la pudeur c’est qu’elle a tendance à vous rendre invisible, parce que vous n’avez pas envie de vous mettre sur le devant de la scène. Moi, j’ai très souvent, dans des dîners par exemple, donné l’impression que je m’ennuyais ou que je n’étais pas là. J’ai eu cette conversation avec ma meilleure amie qui me faisait le reproche que lors d’un dîner entre copains on ne m’avait pas entendu de la soirée. Et je lui ai répondu: «à quel moment auraistu voulu qu’on m’entende?». Il y avait un copain à côté de moi qui a parlé de lui du début à la fin du dîner. Je n’ai jamais été de ceux qui arrivaient à jouer des coudes pour tenir le crachoir. C’est une combinaison honnête de plaisir et d’envie d’écouter les autres et de difficulté à se mettre en avant. Je sais que si on m’avait raconté une histoire très drôle, je l’aurais racontée à mon voisin de table à voix basse pour que lui la raconte à voix haute! Parce que ça m’aurait mis mal à l’aise. La sensation d’être impudique, c’est la sensation de déroger à une norme. Et cette norme est tantôt établie par la société, tantôt par notre génération. J’appartiens à une génération où on disait aux enfants «ne parle pas à table!»… Et c’est un peu resté. Je vois bien que la génération de mes enfants, c’est le contraire. On a envie de leur dire: «posez vos iPad et parleznous!». Mais si la pudeur rend invisible, l’écriture est un espace de liberté où on arrive à trouver cet oxygène.

Dans ce livre, Jeremy dit à Adèle que, dans les romans, les personnages sont plus libres parce qu’ils vivent le temps imposé par leur créateur. Vous pensez qu’on ne sera jamais aussi libres que les personnages de vos romans? Qu’on ne peut pas vivre comme un personnage de roman?
Là, je me bouscule tout seul en disant cela… Je me moque de moi-même. Évidemment que nous sommes aussi conscients que la vie peut s’arrêter du jour au lendemain. Mais on a un peu plus de retenue que les personnages de roman. Évidemment, je suis à la croisée de ces chemins, je me pose souvent la question. Je fais faire des choses à mes personnages et il m’arrive de me demander: «mais qu’est-ce qui me retient moi?»
La notion du temps qui passe est très présente dans ce roman, avec notamment le métier d’Adèle, maître horloger. Le temps, vous avez plutôt tendance à vouloir l’accélérer ou l’arrêter?
Quand j’étais enfant, ma première prise de conscience adulte c’est l’émerveillement de la vie. Très jeune, j’ai un souvenir d’avoir été émerveillé dans notre jardin dans le sud de la France. On avait quelques citronniers et orangers, je devais avoir 8 ans et je suis resté 2 heures dans la pelouse à suivre le boulot des fourmis noires au pied du citronnier. J’étais allé trouver ma mère ensuite pour lui dire: «c’est quand même épatant la vie!». Et elle avait éclaté de rire. Moi, je ne voyais pas ce qu’il y avait de drôle, ça m’avait un peu vexé. Quand j’ai raconté ça un copain d’école le lendemain, il m’avait jeté un regard genre « t’es con ». Je me sentais décalé. À partir de ce moment-là, j’ai toujours trouvé que la vie était trop courte. Je n’avais pas connu mes grands-parents maternels et j’avais pris conscience assez jeune que la mort existait.
>> Découvrez l'interview complète de Marc Lévy ce samedi dans votre magazine Max disponible en librairie dans les journaux Sudinfo ou en cliquant ici.