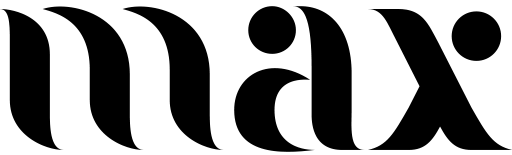Elle rit quand on lui dit qu’elle est un peu la Beyonce belge. Elle bouge aussi bien qu’elle et, au delà d’être une humoriste et une actrice, Nawell Madani est surtout une businesswoman qui force le respect. Partie de rien, à part de sa profonde envie d’y arriver, elle produit et réalise aujourd’hui une série géniale pour Netflix («Jusqu’ici tout va bien», dans laquelle elle joue aussi). Entre parcours de battante -et les combats sont encore nombreux, souligne-t-elle- et vie de famille heureuse, la belle Belge raconte son ascension avec force et conviction. Inspirante.
Nawell, le terme businesswoman, il vous convient bien aujourd’hui?
Sincèrement, c’est parce que les gens me le disent mais moi j’ai l’impression de juste me battre, plus que faire du business! Mais c’est clair qu’aujourd’hui je produis ma série («Jusqu’ici tout va bien»), j’ai envie de produire d’autres choses dans lesquelles je ne suis pas impliquée… parce que je vois des jeunes se battre. J’entreprends pas mal de choses donc, oui, j’ai une casquette «business» aujourd’hui parce que j’ai envie que les choses se fassent.
Parce que, sinon, les choses ne se font pas si on attend?
Tu sais, je partage ma vie avec un acteur noir (Djebril Zonga, récemment nommé aux César pour «Les Misérables»). Les propositions ne tombent pas toutes seules, ça n’arrive jamais. Je lui dis que s’il ne crée pas, il restera dans l’attente, et il deviendra un artiste frustré. Il faut qu’on crée, qu’on pense à nous avant que les autres ne pensent à nous. Je suis dans cette démarche-là. On avance chacun à son rythme, on a chacun sa vision et aujourd’hui il me dit: «t’as raison». Il pensait qu’après «Les Misérables», tout allait arriver. Mais il est plus demandé aux États-Unis qu’en France, parce qu’il est beau gosse, ancien mannequin,…Du coup, là, il tourne dans ma série.
Comment vous l’avez créée cette série pour Netflix?
Je venais de me faire opérer, parce que j’ai toujours une cicatrice de mon accident domestique (à deux ans et demi elle a été brûlée au 3e degré, NdlR). Je dois encore faire un peu de chirurgie réparatrice. J’étais allongée pendant trois semaines et je me suis mise à écrire, c’était juste avant le confinement. Pendant cette période, je regardais beaucoup de séries et je suis tombée amoureuse de «Succession» où la famille est au cœur du récit. Je trouvais ça extraordinaire, ces personnages tiraillés, ces méchants qu’on adore. J’ai regardé «Validé» aussi et je me suis demandé où étaient les meufs! Il y a toujours une prédominance masculine. Et là, j’ai eu envie de raconter cette histoire que j’écrivais. Comme je me nourris souvent de moi, ça parlait de la sororité, de mes sœurs, de mon petit frère qu’on protège, de cette place que j’ai prise au sein de la fratrie et comment beaucoup de femmes deviennent les «hommes de la maison». On est souvent en première ligne de l’éducation et de l’économie, et encore plus dans les quartiers… J’ai voulu parler de ça, en mélangeant thriller et vannes.
Dans votre tête, c’était directement une série pour Netflix?
Netflix ou Canal+, pour la liberté de ton. Et parce que je veux avoir des femmes issues des minorités dedans, je ne veux pas d’acteurs «bankable», je veux du sang neuf. On a envoyé le projet à Netflix et je les ai vus trois semaines plus tard. Ils m’ont dit: «sache qu’on t’attendait. On veut faire un projet avec toi. Ce projet-là nous plaît, il y a encore du boulot mais peaufine». Et c’était signé.
Il y a de l’humour dans cette série, mais surtout des sujets de fond. Votre personnage, Fara, est une journaliste d’une chaîne d’info. On sent que vous voulez dénoncer la désinformation, l’info buzz autour des banlieues…
Oui Fara représente vraiment l’intersectionnalité. Elle subit le racisme, le sexisme, la discrimination au sens le plus large. Moi aussi j’ai vécu ça. Comme dans la scène d’ouverture où le flic tutoie directement Fara, où il lui parle mal, ça m’est arrivé. Je ne sais pas si c’est parce que je suis une femme ou une arabe… Du coup, j’ai nourri le personnage de phrases qu’on m’a dites comme «t’inquiète pas, tout doucement on va oublier d’où tu viens». Et quand j’ai parlé avec des journalistes femmes pour créer ce personnage, elles m’ont vraiment expliqué leur combat, en tant que femmes maghrébines, qu’elles doivent faire trois fois plus que les autres tout en voyant les places leur passer sous le nez. Je me souviens que pour moi, Claire Chazal c’était une icône, c’était la femme qui avait de la poigne. Et aujourd’hui, on n’a pas encore une femme racisée qui présente le JT de TF1, le plus regardé d’Europe. Donc, je me suis dit «j’y vais!». Avec la fiction, tu peux tout inventer! Mais ce n’est pas normal que ça paraisse fou de le faire, que ça n’existe pas en vrai.
En parlant de discrimination, il y a une scène très significative dans la série où Fara, quand elle devient présentatrice, se voit lisser et blondir les cheveux. Vous l’avez déjà vécu ça?
Je pense qu’il y a un complexe et un racisme capillaires. Moi, on m’a en tout cas toujours dit: «lisse tes cheveux, ça fait plus propre». Je n’avais alors pas conscience de ce qu’on me disait… Ma mère, elle, me disait –et c’est dire à quel point on a, nous, des complexes–: «tu ne vas pas aller comme ça, t’es pas présentable!». Si tu y réfléchis bien, quand tu regardes les dessins pour enfants, quand on veut montrer une petite fille un peu fofolle, elle a les cheveux ébouriffés, un peu bouclés! Et quand il y a une meuf kaïra (racaille) dans les films, souvent elle a les cheveux bouclés.
>> Découvrez l'interview complète de Nawell Madani ce samedi dans votre magazine Max disponible en librairie dans les journaux Sudinfo ou en cliquant ici.