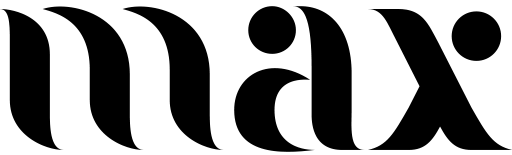On la devinait intelligente et souriante. On la découvre aussi chaleureuse, cool et… très présente, disponible (ce qui n’est pas la moindre des qualités avec son agenda pro surchargé). Il pourrait y avoir une certaine appréhension à l’idée d’interviewer celle qui domine l’exercice aussi bien en radio (France Inter) qu’en télé («Quelle époque!», sur France 2), mais cet a priori, elle le balaie rapidement d’un sourire. Ce jour-là, Léa Salamé nous accorde un long et rare moment, délicieusement interrompu par la visite éclair et surprise de son fils. On a voulu savoir qui est la star de télé, la journaliste numéro 1, la femme, la compagne, la fille, la mère, l’exilée… Elle nous a répondu sans concession, parce que, on le comprend rapidement, elle ne fait pas les choses à moitié, elle qui a la « tiédeur en horreur »…
D’abord, Léa, comment fait-on pour interviewer la reine de l’interview ?
Démerdez-vous! (rires) Je n’ai pas de leçon à donner…
Et là, vous vous dites qu’on vous passe la pommade, ou que vous avez effectivement acquis une grande expérience en matière d’interview?
Je me dis que vous me passez un peu la pommade, mais j’aime bien ça! (sourire) Que je me suis améliorée, oui, je le pense… mais c'est en bossant! Je sais que ma réponse est un peu banale et chiante mais je n’ai pas d’autre réponse que de vous dire que le travail pour moi a été constitutif de toutes mes années de carrière. Je pense que la chance te donne quelque chose, le talent un peu, mais ceux qui y arrivent, ce sont ceux qui le veulent le plus, qui ont la rage. Et ensuite, c’est le travail parce qu’en étant enragé tout court, tu n’y arrives pas.
Vous étiez donc enragée à vos débuts?
Oui, et j’assume d’avoir été enragée. De par mon histoire, de là où je venais –du Liban–, de mon exil, d’une figure paternelle très forte, très puissante, j’étais enragée, il fallait que je prouve, plus que les autres, quelque chose sans doute aux Français, dans le pays dans lequel j’arrivais. Il y avait des souffrances, des chagrins d’enfant aussi qui m’ont dopée pour y arriver. Et j’avais cette idée que si j’y arrivais, si j’arrivais à être quelqu’un, ça apaiserait mes souffrances d’enfant et mes insécurités.
Et arriver à devenir quelqu’un, ça passait par le fait d’être au centre de l’attention? Vous avez fait Sciences-Po et êtes entrée en télé mais vous auriez pu exercer votre métier à un poste moins médiatisé, moins «regardé»…
Sans doute, oui, que je recherchais au début la forme de narcissisme qu’offre la télévision. Mais je ne dirais pas que c’était une volonté absolue. Mon père m’aurait rêvée au «New York Times» ou au «Monde», moi j’ai aimé la télé parce que je suis une enfant de la télé, plus que de la radio d’ailleurs même si j’ai une passion pour elle aujourd’hui. La télé, je l’ai toujours vue comme un objet quand même de divertissement où il y a une part de spectacle, où la forme c’est 50%. Il faut du rythme, que ça aille vite, que ce soit stupéfiant… Ces codes-là de la télé, je les ai toujours acceptés et je les ai même aimés. J’ai une référence, c’est Ardisson, j’admire ce qu’il a fait, c’est-à-dire du divertissement intelligent. Dans cet objet qui ne tire pas toujours forcément vers le haut qu’est la télévision, il a réussi à apporter des penseurs, des écrivains, une réfugiée rwandaise –je m’en souviens j’avais 25 ans– au milieu de la drag queen, de la fille de téléréalité et de la gogo danseuse sur une émission ultra regardée. Et c’est ce mélange-là que j’essaie de faire sur «Quelle époque!». Je crois que j’aime bien parler au grand public, je me sentirais frustrée de ne parler qu’à une chapelle. Peut-être, sans doute, que les 10 premières années de ma carrière, j’ai voulu être reconnue comme une journaliste pas trop nulle par mes pairs, avoir l’assentiment de ce qu’on va appeler le «système». Mais de plus en plus, ces dernières années, je veux ouvrir.
>> Découvrez l'interview complète de Léa Salamé ce samedi dans votre magazine Max disponible en librairie dans les journaux Sudinfo ou en cliquant ici.