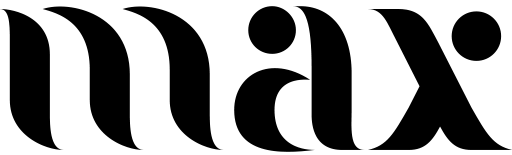Ses yeux pétillent quand elle évoque les rôles qu’elle a su choisir pour grandir et se reconstruire. Son épanouissement, il devrait aussi passer prochainement (et enfin) par un retour à la chanson. «J’ai envie seulement maintenant de refaire de la musique», nous confie Sofia Essaïdi, aussi généreuse dans ses propos que dans ses sourires, 20 ans après qu’on l’ait découverte, et aujourd’hui à l’affiche d’un film pour Disney+, «Antigang: la relève».
Sofia, on vous a déjà vue dans des rôles de flic, mais d’habitude plus rentre-dedans, plus téméraires. Celle-ci est très coincée, parle très poliment…
Oui et c’est justement ça qui m’a donné envie de faire ce film avec cette flic très «control freak», très enfermée. J’ai adoré, justement, les moments où tout ça bascule, où elle perd le contrôle quand le personnage masculin (joué par Alban Lenoir, NdlR) vient bousculer tout ça. Les seuls moments où elle n’arrive pas à contrôler, c’est quand il lui parle. Je ne suis pas comme ça et je me suis demandé ce que ça faisait. Même si j’ai été une très grande «control freak». Du coup, j’ai retraversé ça, je suis allée revoir ce que c’était, sentir dans le bide cette fille qui veut que tout soit parfait. Je le suis beaucoup moins maintenant, je travaille beaucoup là-dessus, sur le lâcher-prise.
Et ça fait quoi alors «dans le bide» de vouloir tout contrôler?
C’est dur. C’est très fatigant de contrôler les choses. C’est du perfectionnisme poussé, sauf que c’est hyper chiant la perfection. C’est vraiment le syndrome de la première de la classe. J’ai une vie beaucoup plus sereine aujourd’hui maintenant que je vis dans le lâcherprise, que j’y travaille quotidiennement.
Vous savez pourquoi vous aviez ce syndrome de «la première de la classe»?
Je pense que c’est l’éducation que j’ai eue, que ce soit à la maison ou dans la société dans laquelle j’ai grandi au Maroc. Une société assez bourgeoise où il faut être le premier de la classe, avoir le meilleur diplôme et le meilleur salaire. J’ai grandi dans cette injonction, ce qui est terrible je trouve. Après, c’est comme ça, mes parents ont fait ce qu’ils ont pu parce que c’est ce que eux aussi avaient reçu comme éducation. C’est davantage une société qui impose ça que des parents. C’est terrible parce que ce n’est pas le plus important: le plus important c’est d’être heureux, épanoui, de trouver sa voie et peut-être même vivre de sa passion et découvrir qui on est. Plutôt que de rentrer dans des moules qui peuvent vous rendre très malheureux avec des très grands salaires et des très grandes maisons! (sourire)
Quand avez-vous compris qu’être parfaite n’allait pas vous rendre heureuse?
Quand j’étais peut-être un peu trop malheureuse. À un moment donné, ça va, on est jeune, on ne réfléchit pas trop puis on mûrit un peu plus et on se rend compte que c’est vraiment très douloureux de toujours voir ce qui ne va pas, plutôt que de se rendre compte de ce qui va. Et c’était ça le truc chez moi: je pouvais faire une prestation –quand je chantais beaucoup plus que je ne jouais– très sympa mais s’il y avait une fausse note dans la chanson, je m’arrêtais là-dessus. C’est très éreintant. Et ça provoque de la colère, je vivais dans la colère. Ce qui n’existe plus aujourd’hui.
De la colère envers vous-même?
Oui. C’est le pire, la colère qu’on s’impose envers soi-même. Et c’est de l’auto-jugement permanent. C’est dur parce que les autres passent déjà leur temps à vous juger… Alors si, en plus, vous-même vous vous jugez tout le temps… (soupir)